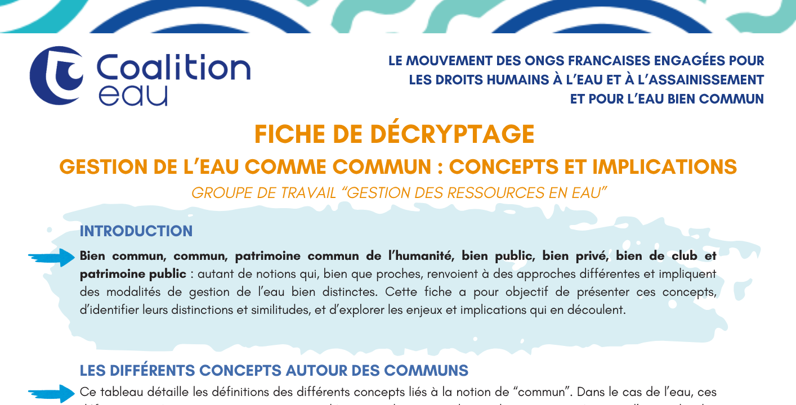6 mois après le cyclone Chido, les parlementaires ont débattu et voté le projet de loi de programmation intitulé “Refondation Mayotte” (examen au Sénat en mai 2025 et à l’Assemblée Nationale en juin). Ce texte s’inscrit dans la continuité du plan “Mayotte debout” annoncé par le premier ministre en décembre 2024 et de la loi d’urgence pour Mayotte, adoptée en février 2025.
Selon le gouvernement, cette loi consiste à organiser une réponse sur plusieurs années, avec une programmation financière estimée entre 3,2 et 4 milliards d’euros. Alors que le cyclone Chido a renforcé la vulnérabilité du territoire déjà fragile, les nombreux dégâts ont à nouveau démontré l’urgente nécessité de travailler sur les causes structurelles de la précarité à Mayotte et d’apporter une réponse globale, notamment en matière d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA).
Objectifs affichés de la loi
Suite à la loi dite « d’urgence » de février 2025, cette nouvelle loi prévoit de :
- Lutter contre l’habitat informel : mesures visant à démanteler les bidonvilles sans obligation de relogement, et à réguler l’urbanisation ;
- Lutter contre l’immigration : durcissement des critères du droit au séjour, déjà plus stricts à Mayotte que pour les autres départements français, et renforcement des contrôles aux frontières ;
- Mener une refondation institutionnelle : transformation de Mayotte en un département-région avec une assemblée unique de 52 membres élu.e.s ;
- Accompagner la convergence sociale : harmonisation progressive de certains droits sociaux avec ceux de l’Hexagone d’ici 2031. Cette trajectoire inclut des mesures concrètes comme le relèvement du SMIC mahorais à 87,5 % du niveau national dès 2026, l’extension du dispositif LODEOM pour l’emploi local, des dispositions sur la santé et la perspective d’une revalorisation des pensions de retraite ;
- Renforcer les infrastructures : des investissements pévus pour moderniser les infrastructures clés de Mayotte, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la sécurité et de l’eau. Ces investissements doivent répondre aux besoins spécifiques liés à la croissance démographique et donc aux besoins croissants en eau. La Loi rappelle les dispositions prises par le « Plan Eau Mayotte » (2024-2027), visant notamment à mettre fin aux pénuries d’eau d’ici fin 2026 en développant la production d’eau (usine de dessalement et retenue collinaire).
Des réponses structurantes pour la production d’eau
En matière d’eau et d’assainissement, la Loi de refondation de Mayotte inclut ainsi bien des dispositions. L’article 2 du texte de loi précise notamment un ajustement des montants prévus par le plan « Eau Mayotte » pour 2024 – 2027, avec 350 millions d’euros jusqu’à 2027. Le contrat de progrès prévoit lui aussi un montant total à 2031 de 730 millions d’euros.
Néanmoins, cette augmentation des investissements prévus risque de ne pas entrainer tous les impacts souhaités si elle n’est pas accompagnée d’un renforcement de l’ingénierie (technique, sociale et financière), du pilotage, de la gouvernance etc.
En effet, selon le rapport de la Cour des Comptes sur « La gestion de l’eau potable et de l’assainissement en outre-mer », publié le 12 mars 2025, les besoins en investissement à Mayotte s’élèvent à 743 millions d’euros, dont 554 millions d’euros pour la gestion de l’eau potable, en raison de la nécessité de créer des réseaux de distribution. Mais le rapport précise aussi le principal enjeu ne réside pas dans la disponibilité des fonds mais dans la capacité de les mobiliser. La part des crédits consommés est inférieure à 50 % à Mayotte par exemple. Par rapport aux besoins en investissements définis dans les contrats de progrès, moins de 10 % des crédits nécessaires ont été consommés à Mayotte.
Des préconisations ont été faites concernant le Plan « Eau Mayotte » et plus généralement sur le PEDOM (sur les contrats de progrès), notamment dans le rapport publié par l’IGEDD (voir ici) et dans le rapport de la Cour des comptes sur « La gestion de l’eau potable et de l’assainissement en outre-mer » (voir ici).
Mais des mesures absentes pour la distribution et l’accès à l’eau et à l’assainissement pour toutes et tous
Malgré les besoins d’amélioration de l’accès aux services essentiels et ce rappel des engagements financiers annoncés dans le cadre du « plan Eau Mayotte », les engagements pris en annexe de la loi (qui n’a pas de portée législative et juridique) ne concernent que le volet production d’eau potable (construction d’une seconde usine de dessalement et d’une troisième retenue collinaire). Ainsi, le projet de loi n’aborde pas les enjeux de distribution et d’accès à l’eau pour la population (alors même que 30% de la population n’est pas raccordée au réseau d’eau).
La réponse technique apportée par le texte de loi (forages, dessalement, etc.) ne répond donc pas à la question de l’accès à l’eau pour toutes et tous sur le territoire, d’autant plus si les personnes t en situation de précarité se trouvent criminalisées (comme c’est le cas actuellement pour les personnes allant se fournir en eau aux bornes fontaines monétiques de l’île).
Pourtant, les mesures introduites par l’ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 202212 prévoit de garantir l’accès de chacun à l’eau destinée à la consommation humaine, même en cas d’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux. Le décret n°2022-1721 du 29 décembre 2022 précise que ces mesures sont applicables à toutes et tous, peu importe la nature du domicile : aucune personne ne saurait donc être exclue de ces mesures ni sur le fondement de la légalité de son occupation d’un lieu, ni au regard de sa situation administrative. Dans le contexte mahorais, cette précision règlementaire vient rappeler le caractère inconditionnel de l’accès à l’eau. En Outre, la question de l’assainissement est totalement absente, alors qu’elle constitue un levier fondamental pour l’amélioration des conditions sanitaires sur l’île et la lutte contre les épidémies. Ces absences soulignent que l’eau, l’hygiène et l’assainissent reste reléguée au second plan dans ce projet de loi, alors qu’il s’agit d’un besoin vital pour la population sur un département français qui a pourtant vu une épidémie de choléra (maladie caractéristique des défauts d’accès à ces services essentiels et marqueur de retard important de développement).
Ce projet de loi représente par ailleurs un risque d’aggraver les conditions de vie des habitant.e.s des quartiers d’habitats informels, déjà en situation d’extrême précarité. Faciliter les opérations de destruction de ces quartiers, sans qu’aucune solution de relogement ne soit proposée, soulève de sérieuses inquiétudes pour la continuité des accès déjà précaires des personnes vulnérables aux services essentiels dont l’eau potable.
L’accès à l’eau et à l’assainissement n’est pas le seul domaine dans lequel le projet de loi manque de mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie à Mayotte. D’autres enjeux fondamentaux, tels que l’accès à la santé ou à l’éducation, sont eux aussi traités de manière secondaire. Cette absence de vision globale interroge, d’autant plus qu’elle touche en premier lieu les publics les plus vulnérables. L’UNICEF, entre autres, a tiré la sonnette d’alarme sur l’insuffisante prise en compte des droits des enfants et des jeunes dans ce texte, en alertant notamment sur les risques accrus de déscolarisation prolongée liés aux expulsions et à la destruction de l’habitat précaire (voir ici).
Sans un véritable travail de concertation, une volonté affirmée de s’attaquer en priorité aux difficultés structurelles de l’île, ainsi qu’une prise en compte équitable de toute la population, indépendamment de la zone d’habitation ou du statut administratif, Mayotte ne pourra espérer une amélioration durable de ses services de base comparable à un département de l’hexagone. Il est donc indispensable de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, y compris les personnes concernées par la grande précarité, pour engager une reconstruction inclusive et respectueuse des droits fondamentaux de toutes et tous.
La mobilisation de la Coalition Eau
Face à ces enjeux cruciaux, la Coalition Eau se mobilise depuis plusieurs années, aux côtés de ses ONG membres et partenaires, pour porter des recommandations concrètes afin d’améliorer les politiques publiques en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les territoires dits d’outre-mer et en particulier à Mayotte. La Coalition Eau avait notamment porté ces sujets auprès des Nations Unies en 2023 lors de l’Examen Périodique Universel de la France par le Comité des Droits de l’Homme (voir article ici) et le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (voir article ici).
A Mayotte, ce plaidoyer se base sur les expertises et expériences des associations mobilisées sur le terrain, telles que Solidarités International qui a produit notamment une série de rapports dans le cadre de son observatoire de l’accès à l’eau et l’assainissement à Mayotte :
- OPUS 1 : Bilan de la crise de l’eau à Mayotte – 2024
- OPUS 2 : Cycles(s) de l’eau à Mayotte et gestion de la ressource
- OPUS 3 : Accès à l’eau potable à Mayotte : sources d’approvisionnement et barrières d’accès
- OPUS 4 : Maladies hydriques et vectorielles à Mayotte