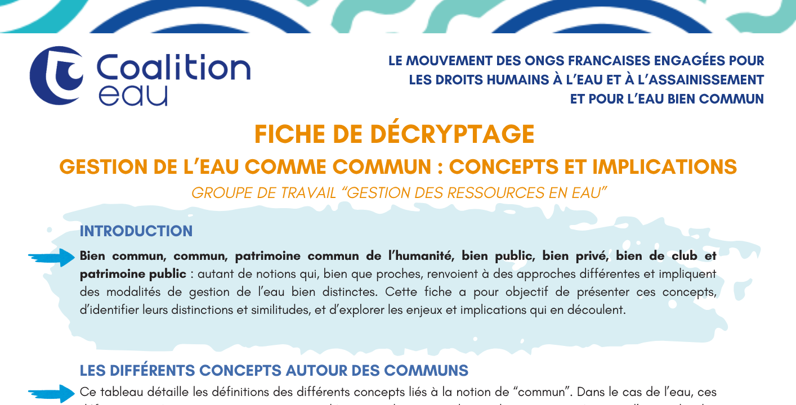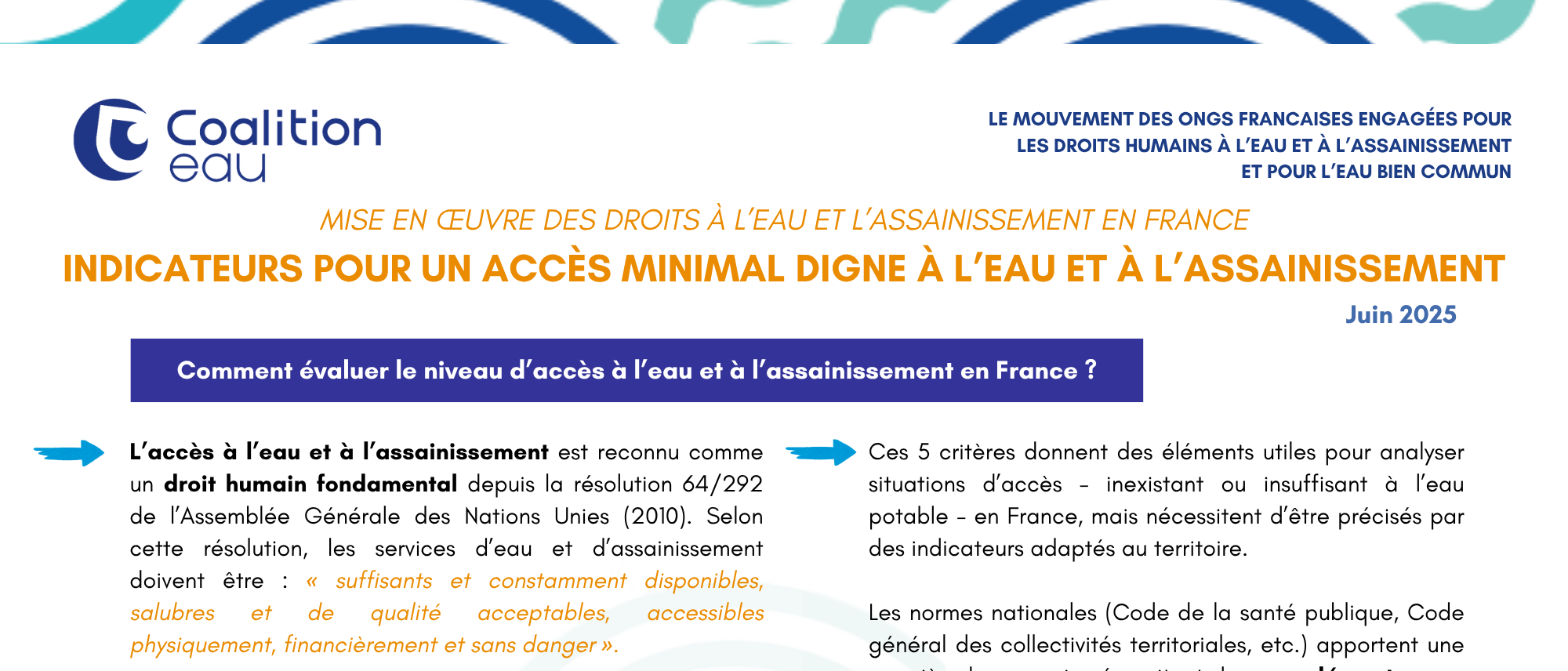La Coalition Eau publie cette première note de décryptage sur les enjeux de tarification des services d’eau et d’assainissement en France, en promouvant une approche par les droits pour des tarifs équitables.
Cette note a pour objectif de :
- Présenter une première analyse des enjeux de tarification des services publics d’eau et d’assainissement en France (Partie II)
- Analyser les enjeux de précarité économique de l’accès à l’eau et à l’assainissement en France, dans une approche fondée sur les droits humains (Partie III)
- Décrypter les dispositifs existants pour garantir l’accès abordable aux services d’eau et d’assainissement (Partie IV)
- Porter des recommandations à l’attention des collectivités et de l’Etat pour garantir un accès abordable à l’eau (Partie V)
Selon la résolution des Nations unies, de juillet 2010, reconnaissant le droit humain à l’eau, le coût de l’accès à l’eau ne peut être en aucun cas un motif d’entrave à la réalisation des droits fondamentaux à l’eau potable et à l’assainissement. En effet, si les services d’eau et d’assainissement sont disponibles mais qu’ils sont trop coûteux, les populations ne pouvant financer des quantités d’eau potable suffisantes sont contraintes de se tourner vers des sources ou des pratiques moins salubres, ou de sacrifier d’autres besoins ou services essentiels, tels que l’accès à l’énergie, l’alimentation, le logement, la santé, l’éducation, etc.
Dans son rapport « L’abordabilité et les droits humains à l’eau et à l’assainissement », Leo Heller, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement, précise à ce sujet :
« Le caractère abordable, en tant que critère des droits humains, exige que l’utilisation des installations et des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène soit accessible à un prix abordable pour toutes et tous. Les droits humains à l’eau et à l’assainissement ont des implications importantes sur la manière dont le paiement des services d’eau et d’assainissement est facturé. Ils exigent des garanties dans le processus de fixation des tarifs et de détermination des subventions, tant en termes de procédure que de fond, ce qui inclut les principes de transparence, d’accès à l’information, de participation et de responsabilité. Ils obligent les États à veiller à ce que le coût de l’accès à l’eau et à l’assainissement soit abordable et réponde aux besoins des individus et des groupes marginalisés et vulnérables. »
L’approche par les droits a pour but de concrétiser les droits des personnes exclues et marginalisées en s’attaquant aux causes structurelles sous-jacentes des inégalités qui découlent des structures politiques, sociales et culturelles. Dans cette approche, les personnes vulnérables sont au cœur des politiques publiques, selon des principes de non-discrimination et d’universalité des droits humains. Cette perception contraste avec l’approche par les besoins, qui considère les inégalités comme un manque d’accès aux besoins fondamentaux, avec une vision parfois restreinte de la notion de besoins fondamentaux, axés sur le matériel. Dans l’imaginaire collectif, qui imprègne encore les pratiques des États et des acteurs du développement, les exclu.e.s sont souvent perçu.e.s comme une minorité. En réalité il s’agit bien de milliards de personnes à l’échelle mondiale, et des centaines de milliers de personnes en France, qui sont exclu.e.s des services à cause d’inégalités structurelles, liées à des facteurs de vulnérabilités très divers.
Avec l’approche par les droits, les politiques publiques mises en place incluent une prise en compte des plus vulnérables au regard des facteurs de vulnérabilité et reconnaissent que ces personnes sont détentrices de droits. Une politique d’abordabilité de l’eau répondant à une approche par les droits consiste à ne pas « invisibiliser » une partie de la population mais à apporter des solutions positives pour un accès durable à l’EAH en fonction de leur spécificité. Il s’agit par exemple d’établir une grille garantissant une équité des tarifs, adaptée à la situation économique et sociale des personnes (comme les grilles tarifaires des cantines publiques ou des transports publics).
Recommandations:
A l’Etat
- Reconnaitre et garantir les droits à l’eau et à l’assainissement (solidarité nationale).
- Définir et caractériser l’abordabilité du service d’eau en France, en prenant en compte les situations des personnes en situation de précarité en eau.
- Instaurer un fonds national « solidarité eau et assainissement » (financé par une taxe de 0.2 centime sur chaque litre d’eau emballée vendue en France) permettant de financer les coûts de mise en œuvre de dispositifs sociaux par les collectivités.
- Renforcer les prérogatives des instances et des mécanismes de règlement des litiges sur la facturation de l’eau, telles que le Médiateur de l’eau et le Défenseur des droits.
- Renforcer le principe pollueur payeur dans le secteur de l’eau.
Aux collectivités
- Conduire les diagnostics territoriaux (selon l’Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine) sur la précarité de l’accès à l’eau, intégrant une dimension de précarité économique, prenant en compte les vulnérabilités des personnes (analyse intersectionnelle de la précarité d’accès à l’eau).
- Assurer un suivi continu des personnes en difficulté, au travers d’une structure ou d’un service dédié (avec un correspondant solidarité-précarité comme établi par l’art. 11 décret 2008-780 modifié) afin de garantir un accès à de l’eau potable pour satisfaire les besoins de base et un équipement d’assainissement.
- Intégrer l’assainissement à la tarification sociale et intégrer l’Assainissement Non Collectif sur la facture de l’Assainissement Collectif, afin de mutualiser les couts de l’assainissement.
- Systématiser la création d’un fonds solidarité logement au niveau départemental, dédié notamment à l’eau potable et à l’assainissement.
- Mettre en place une grille tarifaire incluant une tarification sociale sur le territoire.
- Développer les aides sociales sur la base d’un partenariat avec les acteurs sociaux pour rendre les aides automatiques et significatives, sans oublier les publics éloignés du droit (en situation de rue ou de logement informel).
- Ouvrir les critères d’éligibilité de la politique sociale de l’eau aux personnes vivant en habitat informel et sans droit ni titre et/ou non bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), afin de répondre aux problématiques d’abordabilité pour les populations en situation de grande précarité.
- Sortir l’habitat collectif et les lieux de vie précaires et informels du calcul de la tarification progressive.
- Compenser les contres effets sociaux de la tarification progressive par des mécanismes sociaux adaptés.
- Instaurer une tarification différenciée selon les usages (usage domestique, usage industriel, usage agricole, résidence secondaire) afin de faire avancer les objectifs de justice sociale et environnementale dans la gestion de l’eau tout en gardant l’équilibre économique.
- Instaurer des mécanismes de participation effective des usager·e·s à la gouvernance et aux prises de décisions relatives aux services d’eau et d’assainissement afin de garantir des politiques publiques adaptées et acceptées.