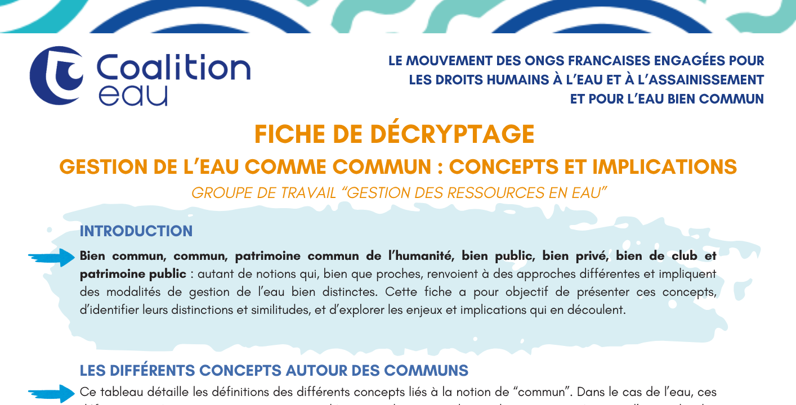Le Président de la République a convoqué un « Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux » le 4 avril dernier. Pour les ONG, cette réunion acte un renouvellement de l’engagement de l’État français en faveur de la solidarité internationale, après une baisse brutale des financements publics. Une tendance également relevée par l’OCDE qui a publié hier les données 2024 de l’aide publique au développement.
Un Conseil présidentiel dans un contexte de baisse mondiale des financements à la solidarité internationale
Selon les données de l’OCDE publiées ce 16 avril, l’aide publique au développement (APD) connaît en 2024 une baisse historique au niveau mondial, sous l’effet de plusieurs coupes budgétaires, fragilisant de fait la lutte contre les inégalités mondiales et la réponse aux crises.
Au niveau français, l’APD ne représente plus que 0,48 % du revenu national brut, un pourcentage inférieur au 0,56 % atteint en 2022 et loin derrière l’engagement de 0,7 %.
Jean Saslawsky, directeur programmes opération plaidoyer de CARE France, rappelle que :
« la lutte contre les inégalités et les crises sanitaires, climatiques ou humanitaires est indispensable pour préserver la paix et répondre aux besoins essentiels des populations vulnérables. Aujourd’hui, 733 millions de personnes souffrent de la faim, 300 millions ont besoin d’assistance humanitaire, et plus de 1,6 million vivent avec le VIH sous la menace de ne plus avoir de traitement, une réalité contre laquelle agit justement la solidarité internationale. Mais les diverses coupes budgétaires au niveau mondial laissent présager du pire pour toutes ces personnes. »
Le Conseil présidentiel, réunissant le Chef de l’État et les membres du gouvernement concernés, est venu réaffirmer l’engagement de la France face à ces constats ; un signal indispensable et attendu par les ONG à l’heure où plusieurs autres pays reculent en matière d’APD.
Un engagement renouvelé de la France à agir face aux crises et à investir dans une transition juste
Lutter contre les inégalités mondiales et l’extrême pauvreté, tout en investissant pour le climat et la biodiversité : un agenda qu’il est en effet nécessaire de réaffirmer, pour Coordination SUD, la plateforme des 180 ONG de solidarité internationale ; mais qu’il faut également clairement différencier des autres politiques (diplomatie, politique intérieure et politique commerciale). La solidarité internationale doit garder comme objectif principal de défendre les droits humains et répondre aux besoins essentiels des populations défavorisées, y compris les personnes migrantes et ce, sans négociations ou conditions dissimulées.
Les ONG saluent le fait que le Conseil ait donné la priorité à l’environnement, à la jeunesse et l’éducation, à la santé mondiale, à l’entrepreneuriat, à la souveraineté alimentaire, aux droits humains et à l’égalité de genre.
En matière de climat, elles s’inquiètent cependant du danger de considérer le gaz comme une solution de transition. Ceci pourrait compromettre les objectifs climatiques collectivement fixés dans l’Accord de Paris, ainsi que l’engagement mondial pris lors de la COP28.
Autre signal positif, le Conseil a précisé son intention de concentrer les financements là où les besoins sont les plus importants et les plus urgents, auprès des « pays et des populations les plus vulnérables », grâce aux actions humanitaires et de développement, deux piliers de cette politique. Des enjeux sur lesquels les ONG sont reconnues pour leur engagement, leur expertise, et leurs capacités d’action grâce aux 50 000 personnes qu’elles emploient aujourd’hui.
Pour Olivier Bruyeron, Président de Coordination SUD :
« dans le contexte mondial actuel, il était essentiel que l’État s’engage auprès des ONG dont les actions et l‘existence ont été fragilisées par la baisse des financements publics en 2025. Il faut désormais que le gouvernement précise quelles seront les mesures qui permettront de relancer notre activité ainsi que celle de nos partenaires dans le cadre du budget 2026 et dans le respect de notre droit d’initiative ».
Soutenir le financement de la solidarité grâce aux taxes solidaires
Face aux difficultés budgétaires et au manque de financements, le Conseil présidentiel a aussi rappelé l’engagement historique de la France en faveur des « contributions mondiales de solidarité ». Ces mécanismes fiscaux, appliqués à des secteurs encore faiblement taxés tels que l’aviation ou les marchés financiers, reposent sur un principe fondamental : les richesses générées par la mondialisation doivent contribuer à la réduction des inégalités, en renforçant l’action en faveur du climat, de la lutte contre les pandémies et en faveur du développement.
« L’Élysée et le gouvernement réouvrent la porte aux taxes solidaires — un signal encourageant que nous attendions avec impatience »
souligne Gautier Centlivre, Coordinateur plaidoyer pour l’ONG Action Santé Mondiale. « Le député Ensemble pour la République Guillaume Gouffier-Valente porte une proposition de loi transpartisane sur ce sujet. Elle doit, dès lors, être intégrée à l’agenda et entrer en vigueur avant le PLF 2026 et inclure la taxe sur les transactions financières, qui à elle seule pourrait générer deux fois plus qu’aujourd’hui si son fonctionnement était amélioré. »
Mieux communiquer sur les actions concrètes
L’Élysée a annoncé plusieurs chantiers au sujet de la transparence et de la « lisibilité et visibilité » de la solidarité internationale, parmi lesquelles le lancement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement et la valorisation de projets financés par la France.
Pour Olivier Bruyeron, Président de Coordination SUD :
« il est indispensable de mieux communiquer sur les actions menées par la société civile grâce aux financements publics. Une majorité de Françaises et de Français s’engage et soutient ces actions, et attend de l’État français à la fois une forte mobilisation dans cette politique dès le budget 2026 et une meilleure information sur son engagement. »