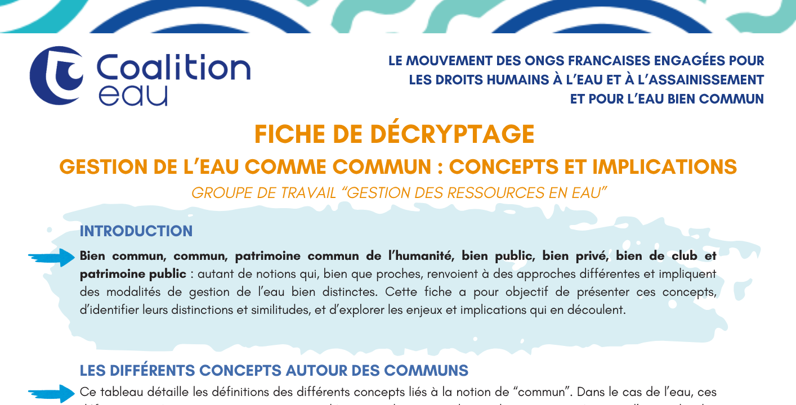Après de nombreux reports, le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement (CICID) s’est réuni en juillet 2023, sous la présidence de la Première ministre et a adopté des orientations de la politique de coopération internationale et de l’aide publique au développement.
Sur la forme, ce CICID s’est réuni sans que la date n’ait été confirmée ou rendue publique, ce qui n’est pas acceptable en termes de transparence et d’inclusion de la société civile, pourtant fortement mobilisée sur ces sujets de coopération internationale.
Sur le fond, si les orientations de la politique de développement sont définies par la loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales (LOP DSLIM) de 2021, les conclusions du CICID viennent préciser les objectifs, les moyens et les modalités de « l’action de la France en matière d’investissement solidaire et durable ». Elles traduisent notamment en termes opérationnels les 10 objectifs stratégiques fixés en mai par le Conseil présidentiel pour le développement, objectifs qui sont précisés à travers des indicateurs de pilotage et de suivi et à partir desquels seront élaborés les futurs contrats d’objectifs et de moyens des opérateurs de l’aide française (dont l’AFD).
QUELLES EVOLUTIONS GLOBALES POUR LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ?
Ce CICID a pris des distances, à plusieurs niveaux, avec le cadre législatif de la loi n° 2021-1031 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, en date de 2021.
A travers ce CICID, le gouvernement promeut l’évolution du concept de solidarité internationale vers un nouveau paradigme autour du terme « d’investissement solidaire et durable ». Les conclusions du CICID mettent ouvertement en avant l’ambition de servir davantage avec les intérêts économiques et les priorités politiques françaises. Cette politique est ainsi présentée comme « à la fois un vecteur de solidarité et donc d’influence, et s’inscrira, plus que jamais, dans une logique de partenariat et de valeurs partagées. »
Le Gouvernement déclare qu’il « renforcera la dimension d’influence économique […] sans revenir sur le maintien du principe du déliement de l’aide » (aux intérêts économiques et commerciaux nationaux), mais le contenu des conclusions du CICID initie un virage clair au travers d’une redéfinition des priorités et objectifs visés par les financements publics émanant de l’APD.
Selon Coordination SUD, la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale, la politique de développement solidaire se doit de poursuivre scrupuleusement les objectifs qui lui sont propres, en premier lieu la réponse aux besoins du développement des pays les plus pauvres et le soutien aux populations vulnérables. Elle ne peut en aucune manière devenir un instrument de pression reposant sur les vulnérabilités des populations des pays. La nouvelle doctrine définie par le Gouvernement tend à se rapprocher de cette instrumentalisation en faisant de l’influence économique au profit des intérêts des entreprises nationales l’un des objectifs premiers de la politique de financement du développement. Une doctrine qui ne reflète en aucun cas l’esprit de la loi sur le développement solidaire de 2021 et met en danger la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires internationaux.
- Analyse des conclusions du CICID par Coordination SUD, ici
- Tribune « Nous appelons à revenir sur le recul sans précédent des engagements de la France pour la solidarité internationale », publiée sur LeMonde.fr, ici
Les avancées des conclusions du CICID :
- Inclusion dans les prêts concessionnels du Trésor et les prêts souverains de l’Agence française de développement de clauses de suspension du service de la dette dans les pays vulnérables ;
- Une hausse de l’aide humanitaire qui passera à un milliard d’euros par an (la stratégie humanitaire 2018-2022 prévoyait d’allouer 500 millions par an à l’aide humanitaire, objectif qui a été atteint pour l’année 2022[1]) ;
- Un focus de l’APD sur les pays les moins avancés (PMA): 50 % de l’effort financier bilatéral et 50 % de l’aide multilatérale devront leur être dédiés[2] ;
- Le lancement des travaux de la commission d’évaluation sur la politique de développement d’ici la fin de l’année[3].
Les reculs :
- L’objectif d’allouer 0,7 % du revenu national brut de la France à l’APD (fixé par la loi sur le développement solidaire de 2021) est repoussé à 2030 au lieu de 2025. Il s’agit d’un recul important, en décalage total avec la loi sur le développement solidaire : avec ce CICID, l’aide publique au développement (APD) perd 5 précieuses années, allant à l’encontre des discours et des engagements du Président de la République qui s’était prononcé en faveur d’un renforcement du financement public lors du Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte Financier Global ;
- Une nouvelle métrique lancée par la France avec un passage de l’APD à un nouvel indicateur – le « Total Official Support for Sustainable Development » (TOSSD) –, permettant de mieux inclure les investissements privés, avec le risque de créer un flou sur les financements publics mobilisés dans le cadre de l’APD ;
- Si le gouvernement acte le renforcement des aides budgétaires en don, aucune cible chiffrée d’augmentation des dons n’est précisée ;
- La société civile et les ONG quasi inexistantes: aucun engagement n’est pris ni aucune orientation précise donnée pour le soutien ou le dialogue avec la société civile. Aucune mention n’est faite à la société civile dans la partie portant sur le pilotage de la politique ;
- Aucune cible financière et indicateurs de moyens pour les Services Sociaux de Base (Education, Santé, Eau, Assainissement, Hygiène et Protection Sociale) ;
- Le gouvernement renforce la dimension d’influence de la France à travers l’APD, notamment l’influence économique dans le mandat du groupe AFD, avec des dispositions très claires cherchant à favoriser la participation d’entreprises françaises dans les projets soutenus.
- Une liste d’indicateurs est proposée pour assurer la redevabilité du Gouvernement mais ces indicateurs ne s’articulent pas avec ceux existant dans la loi de 2021. Par ailleurs, aucune donnée de départ n’est disponible pour évaluer l’impact et aucune cible chiffrée en termes de bénéficiaires ou de volume d’APD bilatérale programmable n’est proposée. Les indicateurs retenus sont très parcellaires et ne constituent pas des indicateurs d’impact de l’APD – ou de l’ISD – française.
Autres aspects :
- Renforcement des leviers et indicateurs favorisant la mobilisation de la finance privée: ces nouvelles orientations ressemblent davantage à une politique d’investissement qu’à une politique d’assistance internationale ;
- Renforcement du pilotage politique et un contrôle/une tutelle du gouvernement plus forte sur l’action des opérateurs de l’aide ;
- La mise en place d’une stratégie unique de l’Equipe France au niveau de chaque pays partenaire, annexée au plan d’action de l’Ambassade et répondant aux enjeux de développement du pays partenaire mais aussi aux priorités politiques françaises ;
- Le CICID supprime la liste des 19 pays pauvres prioritaires (qui étaient tous des PMA africains, à l’exception de Haïti[4]) et les cibles de concentration de l’aide à ces pays (cibles qui n’ont pas été atteintes). Le gouvernement fait le choix d’une cible de concentration de l’effort financier de l’Etat au profit des PMA dans leur ensemble (50 % de l’effort financier bilatéral et 50 % de l’aide multilatérale), avec une inclusion très prochainement des Etats vulnérables.
QUELLE PRISE EN COMPTE DE L’EAU ET DE L’ASSANISSEMENT ?
Si certains services sociaux de base, comme la santé et l’éducation sont bien pris en compte parmi les 10 objectifs stratégiques de la France, aucun objectif prioritaire n’est dédié spécifiquement à l’eau, alors qu’il s’agissait d’un secteur prioritaire dans la loi LOP-DSLIM.
Pourtant, l’ampleur des défis en matière d’accès et de gestion de l’eau est énorme. Selon le rapport de synthèse sur la mise en œuvre de l’ODD 6, le constat est alarmant tant la réalisation de l’ODD n°6 est loin d’être satisfaisante :
- 2,2 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d’un accès à l’eau géré en toute sécurité et 3,5 milliards vivent sans un accès à l’assainissement géré en toute sécurité (Rapport du Joint Monitoring Program 2023, OMS/UNICEF)
- Si l’environnement continue à se dégrader et si les pressions sur les ressources mondiales en eau restent aussi insoutenables, 45 % du PIB mondial, 52 % de la population mondiale et 40 % de la production mondiale de céréales seront menacés d’ici 2050 (Stratégie internationale de la France pour l’EAH)
D’après le dernier rapport du Joint Monitoring Program (OMS et UNICEF) :
- Le monde ne tient pas le bon cap pour atteindre l’ODD 6 et les financements consacrés à l’eau et à l’assainissement sont insuffisants
- Atteindre la couverture universelle d’ici 2030 nécessite des progrès 6 fois plus rapides pour l’eau potable et 5 fois plus rapides pour l’assainissement, par rapport aux taux de progression actuels.
Mention de l’EAH à travers des indicateurs
L’enjeu de l’accès à l’eau et à l’assainissement est toutefois présent indirectement dans plusieurs objectifs, à travers deux indicateurs de redevabilité (Annexes des conclusions du CICID) :
- Pour l’objectif 2 (protection des réserves de carbone et de biodiversité), un indicateur permettra d’identifier les superficies bénéficiant d’un programme de conservation, de restauration ou de gestion durable de la biodiversité terrestre, aquatique et maritime et dont l’état des écosystèmes a été améliorée.
- Pour l’objectif 6 (infrastructures stratégiques dans les pays en développement), un indicateur spécifique permettra de suivre le nombre de personnes gagnant un accès durable à une infrastructure essentielle : eau, électricité, transport, assainissement….
Plusieurs aspects sont à regretter sur ces 2 indicateurs :
- La gestion des ressources en eau reste absente des objectifs, des moyens et des indicateurs de redevabilité
- Les indicateurs ne sont pas des indicateurs d’impacts et ils ne bénéficient d’aucune cible chiffrée en termes de volume d’APD bilatérale
- Le suivi du nombre d’infrastructures d’accès à l’eau et à l’assainissement est déjà réalisé par l’AFD, l’indicateur proposé ne représente donc pas de nouveaux engagements
- Le secteur eau et assainissement reste considéré sous un angle infrastructurel et non comme un droit humain et un service social de base
Avec cette entrée « infrastructures stratégiques », il est à craindre que les financements pour l’accès à l’eau et à l’assainissement continuent de s’orienter majoritairement vers les grands projets, davantage capitalistiques et à forte rentabilité, donnant la priorité aux programmes urbains, avec un risque de délaissement des zones rurales, malgré les forts besoins et les enjeux en présence.Or selon le Rapport du Joint Monitoring Program de 2023 (OMS et UNICEF) :
- 4 personnes sur 5 ne disposant pas au moins d’un service élémentaire d’eau potable en 2022 vivent en zone rurale ;
- 9 personnes sur 10 qui pratiquent la défécation à l’air libre vivent en milieu rural (377 sur 419 millions).
L’EAH : UN PRÉREQUIS POUR PLUSIEURS OBJECTIFS PRIORITAIRES
La gestion durable et l’accès à l’eau sont directement liés à plusieurs objectifs prioritaires identifiés par le CICID :
- Objectif 1. Accélérer la sortie du charbon et financer les énergies renouvelables dans les pays en développement et émergents pour limiter le réchauffement climatique global à 1.5°C. La production énergétique est fortement dépendantes des ressources en eau, qu’il s’agisse d’hydroélectricité, de nucléaire, d’énergie thermique… Par ailleurs, bien gérer l’eau apporte des solutions pour répondre aux défis du climat.
- Objectif 2. Protéger les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité, dans les forêts et l’océan, pour préserver la planète. La pollution de l’eau et sa surexploitation sont parmi les principaux facteurs d’érosion de la biodiversité et de destruction des écosystèmes.
- Objectif 3. Investir dans la jeunesse en soutenant l’éducation et la formation des professeurs dans les pays en développement. Une éducation de qualité nécessite des infrastructures sanitaires de base : 3 écoles sur 10 dans le monde ne disposent pas de service élémentaire d’eau potable et d’installations sanitaires élémentaires. Les maladies liées au manque d’eau et d’assainissement entrainent un fort absentéisme scolaire.
- Objectif 4. Renforcer la résilience face aux risques sanitaires, y compris les pandémies, en investissant dans les systèmes de santé primaires et en appuyant la formation des soignants dans les pays fragiles : pas de résilience face aux risques sanitaires, sans services d’eau et d’assainissement durables et de qualité. 1,8 milliards de personnes consomment aujourd’hui une eau contaminée. Les maladies diarrhéiques liées à une eau insalubre et à un assainissement inadéquat sont la 2ème cause de mortalité infantile.
- Objectif 7. Renforcer la souveraineté alimentaire, notamment en Afrique : pas de souveraineté alimentaire, sans gestion intégrée et durable des ressources en eau.
- Objectif 9. Promouvoir les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes: les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre sont touchées de manière disproportionnée par le manque d’accès à l’eau et aux équipements sanitaires. D’après l’OCDE, 90% des tâches liées à la collecte de l’eau et du bois en Afrique sont assurées par les femmes. La sécheresse impose aux femmes des trajets de plus en plus longs et de plus en plus dangereux pour chercher de l’eau. Ce sont les jeunes, et surtout les jeunes filles, qui sont mises à contribution pour les tâches domestiques et quotidiennes. Cela favorise leur déscolarisation.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans l’ensemble, ce CICID constitue une opportunité manquée : il n’a pas été un temps fort pour mettre la lumière sur les enjeux de développement et pour remobiliser le gouvernement sur cette politique. Ces conclusions n’affichent pas de nouveaux objectifs ambitieux d’ici la fin quinquennat. Par ailleurs, l’articulation entre certaines décisions du CICID et les orientations de la Loi sur le Développement solidaire n’est pas claire.
Par ailleurs, les enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement sont abordés par ce CICID uniquement sous un angle « infrastructures », et non comme des droits humains et services sociaux de base dont l’accès devrait être garanti à chaque être humain. L’eau comme élément naturel (gestion des ressources en eau) n’est pas mentionnée. Ainsi, l’eau ne semble pas être considérée par le CICID comme un défi majeur à l’échelle mondiale malgré l’ampleur de la crise qui touche les quatre coins du globe : pénuries, inondations, destruction d’écosystèmes, impacts du changement climatique sur l’eau, etc.
Cependant, si les principales orientations du CICID 2023 n’en font pas explicitement mention, l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement reste l’une des priorités sectorielles définies dans le cadre de la loi de développement solidaire du 4 août 2021 (LOP-DSLIM).
L’eau et l’assainissement sont ainsi l’un des piliers de la politique de développement de la France :
- Stratégiquement : L’EAH est une priorité de la loi sur le développement et la France a élaboré et publié une Stratégie internationale pour l’Eau et l’Assainissement pour 2020-2030.
- Financièrement : En 2022, le groupe AFD a engagé 1,2 milliard d’euros en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement, soit 10 % des engagements du Groupe[5].
- Diplomatiquement : La France est particulièrement investie dans les enceintes multilatérales liées à l’eau et s’est fortement mobilisée à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur l’eau en mars 2023.
Pour la Coalition Eau, ce CICID est largement décevant et n’est pas à la hauteur des enjeux actuels. Pour les prochaines étapes, il est essentiel que les problématiques d’accès et de gestion de l’eau soient prises en compte et consolidées dans la déclinaison des 10 objectifs prioritaires et de leurs 20 indicateurs en vue du futur Contrat d’Objectifs et de Moyens entre l’Etat et l’AFD.
[1] Bilan des engagements de la stratégie humanitaire française 2018-2022, Groupe URD, janvier 2023
[2] La loi sur le développement solidaire de 2021 prévoit une cible d’allocation de 0,15 à 0,20% du RNB français aux PMA.
[3] La création d’une commission d’évaluation indépendante a été actée dans la LOP DSLIM de 2021
[4] Les 19 pays prioritaires définis par le CICID du 8 février 2018 étaient : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.
[5] https://www.afd.fr/fr/ressources/eau-et-assainissement-bilan-activite-2022